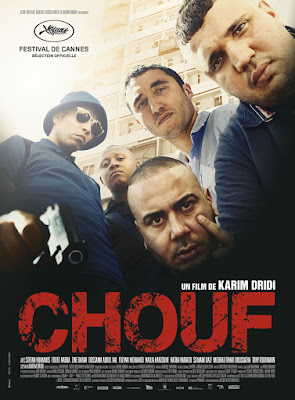Connaissez-vous Andrew Bujalski ? Non ? Normal, ces films n'ont pas le droit de sortie chez nous. C'est dommage qu'aucun distributeur n'ai eu le courage (l'inconscience ?) d'essayer d'en montrer quelques uns, ces films sont charmants comme tout. Sorte de petit frère de Hal Hartley, mâtiné de Philippe Garrel américain, à moins qu'on ose littéralement d'aller jusqu'à le comparer à Rohmer, l'influence la plus visible de ses films, le réalisateur n'est intéressé que par les histoires d'amour et les petits coeurs qui battent fort.
MUTUAL APPRECIATION, son deuxième film réalisé en 2005 juste après FUNNY HA HA que j'ai chroniqué dans ce blog il y a quelques semaines, est un peu son JULES ET JIM. Mais une histoire d'amour d'étudiants, filmé dans des vingt mètres carré, où on parle beaucoup de ses sentiments, où on passe beaucoup de temps à s'en excuser: ces jeunes ne couchent pas vraiment beaucoup, et font tout un pataquès lorsqu'ils finissent par s'embrasser. C'est mignon comme tout (et tellement rafraîchissant; si vous voulez du raide, filez voir un Harmony Korine ou un Larry Clarck, plutôt).
Lawrence vit avec Ellie, qui en pince un peu pour Alan, le meilleur copain de Lawrence qui débarque de Boston avec sa guitare pour faire quelques concerts à New York. Alan qui a fait la connaissance de Sara, animatrice de radio rock qui lui fait du rentre-dedans, et présente son frangin qui est batteur, et Alan a justement besoin d'un batteur pour ses concerts. Ellie en pince aussi pas mal pour Alan, et ils vont se le dire, en se touchant à peine.
Lawrence est incarné par le réalisateur lui-même (physique d'empoté de service, assistant universitaire à lunettes) et Alan par Justin Rice, vrai musicos et figure de la scène pop indé new yorkaise (physique d'empoté, entre Adam Greene et Reda Kateb). Filmé dans un noir et blanc gracieux, les scènes s'enchaînent autour de quelques verres, parfois lors de séquences pompettes qui nous rappellent au bon plaisir de Hong Sang Soo (autre admirateur de Rohmer), et sur des plumards - désolé il n'y a pas assez de chaises... - qui les attendent bras ouverts (mais Ellie et Alan, juste bien élevés, vont résister à l'appel du câlin tandis que Sara y culbute sans préliminaire cet empoté d'apprenti rock-star).
Après avoir vu ses deux premiers films, on est curieux de savoir si Andrew a mûri passé la trentaine, et s'il a laissé ses années étudiantes derrière lui. On verra donc tout ça si jamais on tombe sur ses films suivants mais une chose est sûre; il serait dommage qu'il égare en route cette naïveté toute fraîche de presque puceau qui nous rappellent quelques souvenirs, de môches comme de très beaux, et qu'on regrette à chaque fois qu'on y repense.
(à voir sur Mubi)
Très heureux de tomber, enfin, sur THE TRIBE de Myroslav Shlaboshpytsyi (oui oui), réalisé en 2014, que j'avais manqué en salle et qui se traîne une réputation aussi flatteuse que sulfureuse. Mais quelle horreur que ce film, dans tous les sens du terme.
Qu'on me comprenne; je suis un grand admirateur du travail de Michael Haneke, qui a inventé quelques dispositifs de mise-en-scène frontaux, jamais employés avant lui, et qui nous ont mis face à nos propres terreurs, à la violence la plus extrème, comme aux horreurs les plus absolues avec une absence totale de filtre et d'écrans intermédiaires que j'ai longtemps trouvée fabuleuse, avant que ce ne soit érigé en système. Et là encore, il avait le droit d'user jusqu'à la corde les procédés qu'il avait lui-même mis en place.
Tout comme je suis un admirateur de FUNNY GAMES ou du RUBAN BLANC, je défendrai jusqu'au bout un film comme le dernier Lars Von Trier, THE HOUSE THAT JACK BUILT, et il sera donc inutile de me traiter de mijaurée car... THE TRIBE, non vraiment, quelle putasserie.
Ce film ne m'a pas fait penser à Michael Haneke, ni à Ruben Ostlund qui, lui, a dévoyé le système "je tire sur la corde jusqu'à ce que ce soit insupportable" sur un mode plus goguenard, quoique parfois assez pénible, mais à cet autre film qui "voulait faire comme" Haneke, l'insupportable THE GREAT ECSTASY DE ROBERT CARMICHAEL de Thomas Clay, en 2005, avec ces interminables plans-séquences en plan fixe sur une scène de viol et de torture.
Entre FUNNY GAMES et le snuff-movie, il y avait effectivement cette place que des cinéastes comme Clay ou Shlaboshpytsyi se sont donc chargé d'occuper, histoire d'aller plus loin sans doute, et évacuant de fait toute précaution au profit d'une évaluation brute de la violence. Sur ce schéma simpliste: "la violence, c'est ça", il n'est effectivement pas utile d'y aller par quatre chemins, juste d'exiger de l'endurance de la part de ses interprètes (scènes de cul en temps réel, scènes violentes captées sans jamais "regarder ailleurs"), ainsi qu'une solide préparation préalable de ses techniciens.
Procédé qui affiche tout de même une absence fondamentale de confiance en un système de narration, ici la fiction cinématographique, au profit d'une autre croyance qui a plus à voir avec les systèmes de caméra-surveillance. Certes ici, l'image est autrement plus stylée (c'est ce qui rajoute à l'insupportable: Haneke faisait "voir" le crime de l'adolescent de BENNY'S VIDEO par le cadrage approximatif et un mauvais grain de caméra VHS, et même Von Trier avec sa manière sadique de retarder "les plans qu'il ne faut pas montrer" se révèle presque plus roué et inventif que son psychopathe de concours), et souvent la caméra bouge, et accompagne ses personnages lors de gracieux travellings (ce sont les plans où les prostituées et leur mac tapent à toutes les cabines de poids lourds sur cet air de repos, jusqu'à ce qu'un routier intéressé leur ouvre, ou lorsque les petites frappes circulent dans les couloirs de l'internat et ouvrent les portes brutalement), mais voilà une manière de faire qui exonère le metteur en scène de se mouiller plus que ça: "je vous montre comment ça se passe, c'est dégueulasse, hein ?..." Merci du cadeau.
On pourrait s'arrêter là et dire qu'il s'agit du travail appliqué d'un cinéaste maître de sa technique, qui s'est laissé happer par sa virtuosité et son "idée", mais nous avons à faire ici avec "Monsieur Plus" du trash pseudo-intello, le nouveau Maître Balsen du trip tarte-à-la-crème, car le film se passe entièrement chez les sourds-muets. C'est la "tribu" du titre, un pensionnat spécialisé pour jeunes adultes en Ukraine où règne la loi du plus fort: tabassage, racket, viols, mise sur le trottoir de certaines filles, responsables d'établissement (sourds-muets eux aussi) corrompus, et qui nous offre le spectacle assourdi, sans explication ni dialogues, d'une violence brute dont on comprend tous les enjeux, sans effort.
Rien de plus compréhensible en effet que le spectacle des pulsions les plus animales, et quand le cinéaste nous "montre", dans la scène "Monsieur Plus" du film, un avortement clandestin dans tous ses détails, il profite aussi de l'absence des hurlements et des pleurs pour se régaler dans l'outrance. Effectivement, mon bonhomme, on ne nous l'avait jamais faite celle-là. Quand les malades de FUNNY GAMES abattaient le petit garçon, un plan sur le visage de sa mère suffisait bien (et disait beaucoup plus qu'un crâne en bouillie). Même filmé de loin, THE TRIBE nous montre tout, comme s'il fallait tout voir pour comprendre.
Or, s'il fallait tout un film pour nous expliquer que ce type de violences fait florès dans les pays de l'Est, pourquoi en rajouter pour nous dire que chez les sourds-muets, c'est pareil ?
Ou quelque chose m'a échappé, ou bien ce film est une ordure.
Une ordure, il y en a une aussi, peut-être même plusieurs dans ce classique du cinéma allemand de l'immédiate après-guerre (1946), que la chaîne Arte diffuse assez régulièrement, et qui reste un des rares grands films allemands à avoir dénoncé la dénazification "encore à faire" à cette époque, la nation toute occupée à reconstruire ses murs avant le reste. LES ASSASSINS SONT PARMI NOUS est un film important, et qui a du faire grincer quelques dentiers là-bas (l'ordure en question, un ancien capitaine de la Wermacht qui a fait exécuter des civils sans motif sur le Front de l'Est, est aussi un architecte du renouveau, un "premier de cordée" comme dirait l'autre, qui s'est rebâti illico une fortune en fondant... les casques de l'armée pour en faire des casseroles).
Mais entre ce film, quelques autres et le renouveau du cinéma allemand dans les années 60, celui-ci s'en était tenu à des sucreries en costume pour panser ses plaies. C'est un très bon film, pas aussi noir et décisif, évidemment, que le fameux ALLEMAGNE ANNEE ZERO de Rossellini, mais qu'un cinéaste allemand ait pris à bras le corps le problème, sans fioriture, était déjà un acte courageux, et d'importance (l'ancien officier qui déguste son café-pain d'épice avec son journal à côté titrant: "Deux millions de victimes gazés !", c'était plutôt raide pour l'époque).
Ajoutons que le titre sera emprunté par Simon Wiesenthal pour ses mémoires de chasseur de criminel de guerre. Comme quoi, le film avait marqué.