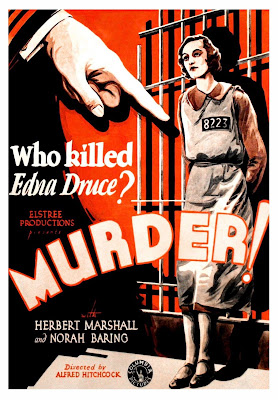J'avais pourtant gardé un très bon souvenir des deux seuls films que j'avais vus de lui, HYENES et LA PETITE VENDEUSE DE SOLEILS et là, je me suis un peu demandé où j'étais. J'ai fini par comprendre d'où venait le problème, une fois le film terminé et ruminant mon désarroi; j'avais abordé le film sous un mauvais angle. Je n'avais pas vu que TOUKI BOUKI, indéniablement sous influence Nouvelle Vague, cherchait à faire un peu PIERROT LE FOU, un peu A BOUT DE SOUFFLE à Dakar. Nous y suivons le parcours tout en zigs et en zags de Mory et Anta, lui beau gosse un peu voyou qui se ballade d'un air fier sur sa moto ornée de cornes de zébu, elle belle plante avec des faux airs de garçon manqué.
Le film a l'air un peu dépenaillé, comme ça, se permettant de curieux effets de retours en arrière et de séquences oniriques qu'on prend d'abord au pied de la lettre, avant de s'apercevoir que c'était, un peu, pour nous blouser. Mory vole un joueur de bonneteau, Mory arnaque un riche homo dans sa baraque avec piscine, Anta vide les sacoches laissés sur un banc, Anta et Mory font l'amour sur la plage (superbe séquence; Mambety était un sacré filmeur, notamment dans son traitement des couleurs, absolument éclatantes), Mory et Anta veulent se payer leur billet pour la France.
Le principal problème, c'est que le film a vieilli, et ce qui pouvait passer pour de l'audace dans les années 70, agrémentée de procédés arty pas toujours utiles, qui soulignaient jadis, alourdissent aujourd'hui. Dans ce Sénégal post-colonial, il y avait encore quelques comptes à régler: on se moque de l'érection d'un monument à la mémoire de De Gaulle (Anta et Mory vont d'ailleurs piquer la recette de la fête donnée en cet honneur), ou encore de la logorrhée verbale de ces blancs toujours remplis de paternalisme sournois et de condescendance raciste.
On préfèrera par exemple à ce personnage absurde et idiot de petit blanc rendu à l'état sauvage (il loge dans un arbre, s'habille en peau de bête) et qui finit par voler la moto de Mory, cette simple séquence documentaire dans un abattoir, qui ouvre le film, terrible, affreuse, où des hommes pataugent dans les viscères, leur machette à la main, dans le vacarme des bêtes qui meuglent. Le film s'achève d'ailleurs sur un plan fixe sur un jeune garçon-vacher menant ses bêtes dans la savane. Mambety saura plus tard comment traiter de grands problèmes avec des idées toutes simples comme celle-là. TOUKI BOUKI est un film qui n'a pas bien vieilli à cause de ça.
Je n'avais jamais vu de film de Straub & Huillet, et voilà: au bout de 45 minutes d'endurance pacifique avec des envies folles de bousiller un truc à mains nues, j'ai éteint. C'était ça ou c'est un de mes gosses qui allait prendre (je plaisante, ils sont trop grands...).
Résumons: Sophocle écrit cette pièce, délivre un des personnages les plus inépuisables du théâtre ancien et moderne, qui sera repris par maints écrivains et poètes. Hölderlin, le poète allemand pouet-pouet, entre autres, que Brecht reprendra et réécrira en y mettant toute sa ferveur politique. Le tandem Straub-Huillet reprend cette version en plantant ses caméras et plusieurs comédiens allemands, qui se prennent des coups de soleil de Toscane sur leurs peaux de blondinets, tout habillés de toges colorées et chaussés de cuir tressé, dans ce qui semble être des ruines d'un vieux théâtre antique.
Séquences statiques, comédiens qui ne bougent pas les pieds, parfois un choeur antique qui meugle (gros plan sur des dalles blanches dans la terre jaune), autre scène, comédiens qui ne bougent toujours pas, re-choeur antique qui meugle (et là, gros plan sur les dalles blanches mais... un bon mètre en décalage avec la fois précédente), et tout ceci est tellement sec, tellement vide, tellement énervant qu'on en oublie d'essayer d'écouter le texte.
Avec cet ANTIGONE, filmé en 1992, on tombe au fond de quelque chose qui a peut-être à voir avec le respect le plus profond pour un texte mais, aussi, avec ce que je n'irai pas jusqu'à appeler du mépris, mais du déni d'un certain public. Deux genres de public, peut-être, apprécieront (ou feront semblant d'apprécier, ou diront avoir apprécié): les "spécialistes" du texte, voire du personnage, ou encore de ce théâtre-là (ce serait donc un film de spécialistes pour spécialistes), et les cinéphiles dont je connais l'existence (c'est la frange des lecteurs des Cahiers du Cinéma que je ne supporte pas), et qui pensent que la quintessence d'un certain cinéma se trouve là, comme dans les Godard les plus impossibles.
On a envie de leur crier, à tous ceux-là; restez entre vous. Votre cinéma-théâtre, ou théâtre-cinéma est chiant, moche et, comble de tout, pas formidablement bien interprété, pas extraordinairement bien filmé. Serait-ce trop demander que d'avoir une mise-en-scène généreuse, des comédiens qui se lâchent, qui osent des choses folles, qui puissent transcender un texte qui m'a semblé... un peu vieilli ? Et autre chose, en guise de cinéaste, qu'un trépied ?
Allons, allons, j'ai arrêté à la moitié... il faut être honnête. Si j'avais été jusqu'au bout, j'aurais vécu l'étincelle et j'aurais a-do-ré. Et pour prouver ma bonne fois, pas plus tard que dans pas longtemps, je me ferai un autre Straub/Huillet et si ça se trouve, je vais adorer.
Nie aufgeben !
J'ai revu ONCLE BOONMEE (Celui qui se souvient de ses vies antérieures) 10 ans après sa sortie, et j'ai retrouvé ce même phénomène inexplicable de sérénité, cette même impression de me retrouver sur une terre parallèle, mais sans danger. Car autant l'univers de Lynch, on le sait, est lui aussi définitivement ailleurs, mais il est lourd de menaces, peuplé de monstres agressifs et hostiles, autant les mondes de "Joe" (son diminutif, bien pratique) sont étranges, parallèles mais pacifiques. Cette particularité m'a sauté aux yeux en le revoyant, dès les premières scènes: cette scène incroyable où le fantôme de l'épouse défunte apparaît (un des convives sursaute, et c'est tout), suivie de la montée des marches du premier homme-singe, qui n'est autre que le fils disparu de la soeur de Boonmee, et qui s'installe à la table, lui aussi, pour expliquer ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui "lui est arrivé", mais une chose qu'il a décidé lui même...
Là où d'autres cinéastes, tous les autres en fait, joueraient avec les codes du film de revenants, voire avec le film d'horreur, lui pose la scène comme, quelques minutes plus tard, ce moment anodin mais tellement beau, où Boonmee demande à sa soeur si elle veut du miel: ils vont vers une ruche, lui en ouvre une, en lève un cadre et, ensemble, se régalent et se lèchent les doigts, sans la moindre crainte d'une piqûre.
Le genre fantastique vous propose de craindre ce qui n'existe pas, de provoquer une peur irrationnelle. Dans cette scène, on n'a pas peur un seul instant de ce qui risque pourtant, normalement, d'arriver (et les personnages, et les acteurs non plus...)
J'ai aussi compris pourquoi Tim Burton avait donné la Palme à un film qui n'aurait pas du l'avoir, en revoyant la séquence, chef-d'oeuvre dans le chef-d'oeuvre, qui arrive là comme un flash-back mais n'a en fait aucune justification à se trouver dans ce film-là plutôt que dans un autre (ce qui en dit long sur la liberté de "Joe" vis à vis de son travail): l'épisode de la princesse.
Un passage qui possède la perfection d'un conte oriental autant que celle du très grand cinéma: cette femme à la peau grêlée dont l'eau lui renvoie un visage parfait, et fait offrande de tous ses attributs (bijoux, voiles, virginité) à la rivière et se donne au poisson-chat, ne pouvait qu'émouvoir l'inventeur d'Edward Scissorhands.
Pour le reste, soyons honnête, j'ai buté à peu près sur les mêmes moments: ce défilé de photogrammes sur des hommes-singes capturés par des militaires souriants, ce drôle de final avec les personnages qui se dédoublent. Rien n'est terminé dans les films de "Joe", surtout pas quand le film est fini.