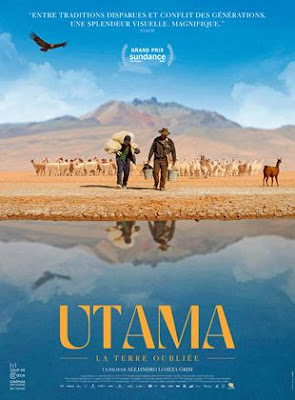Nathalie Alvarez Mesen est suédo-costaricienne ce qui pour commencer n'est pas banal, et son premier film se déroule justement au Costa-Rica, pays jamais filmé ou rarement, dans une ferme perdue au fond des bois dans laquelle vivent la vieille Fresia, Clara la seule enfant qui lui reste, et ses trois petits-enfants. C'est un endroit bien loin du monde, ni accueillant ni hostile où subsistent encore une manière de vivre des plus frugales ainsi que des traditions religieuses assez particulières. Clara a plus de 40 ans, n'a jamais connu d'hommes et la communauté la préserve telle une sainte dans sa vitrine, comme un rosaire dans un tiroir fermé à double tour.
On ne s'y attarde pas bien longtemps, mais il a été question d'apparition de la vierge un jour, de pouvoir de guérison par apposition des mains, de don de voyance et Clara ne doit pas sortir d'un certain périmètre dans les champs alentour, et sa mère lui trempe chaque soir le bout des doigts dans une décoction de piment afin qu'elle cesse de se toucher. Clara Sola a été décrit un peu partout depuis sa présentation à Cannes l'an dernier dans la section Un certain regard comme un film "féministe" qui dénoncerait la condition féminine dans certaines parties du monde, mais les femmes ne sont pas toutes ici logées à même enseigne. Le film n'a pas besoin de cette appropriation par l'air du temps et par ce qu'il veut bien y voir pour se montrer singulier, car cette claustration exclusive est avant tout le fait d'une mère possessive qui craint pour sa fille comme pour un vase précieux mais d'une fragilité inimaginable.
Un peu bossue, le visage si dur qu'elle semble prête à toutes les malédictions, le verbe et la diction lente, quand ses traits s'illuminent soudain le plus beau sourire du monde apparait, quand elle dessine un geste fugace mais précis dans l'air des choses se passent, les animaux viennent à elle et même, parfois, la terre bouge. C'est l'équilibre d'un monde qui repose dans la carcasse voûtée mais décidée de Clara, sainte malgré elle qui brûle d'un feu intérieur très humain, femme malgré tout, non désirée mais follement désirante.
C'est la présence pour la saison touristique d'un jeune ranchero venu s'occuper de leur superbe jument blanche, avec laquelle Clara entretient un lien des plus fusionnels qui va peut-être tout déclencher. Mais ce n'est pas tout. Si Clara soigne les gens autour d'elle et possède même ce pouvoir de ramener les morts au vivant, on lui refuse de s'occuper de cette malformation du dos qui à son âge commence à lui peser, on lui dénie le droit de se faire belle pour les grandes occasions, alors que sa jeune nièce pas encore adulte peut se le permettre.
Le film de Nathalie Alvarez Mesen possède cette grâce d'esquiver les deux pièges tendus par ce scénario moins basique qu'on a bien voulu le voir (contrairement aux critiques occidentaux, toujours prompts à obtempérer aux effets de mode): même s'il en est question, l'émancipation féminine n'est pas le sujet, il est juste question de l'émancipation d'une femme dont on ne sait si elle est un peu folle, ou idiote, un peu sorcière, mais que sa famille et la communauté veulent préserver à tout prix. Même s'il en est question, la piste fantastique est simplement esquissée elle aussi: même si les colères de Clara font trembler la terre, même si elle ramène à la vie un coléoptère en lui soufflant dessus, même si elle commande à son cheval pourtant rétif en quelques mots.
C'est la plus belle idée du film, son noyau dur en quelque sorte, dont il ne se départit jamais, qu'entre foi religieuse et pensée magique il n'y a rien d'autre que du doute, des croyances, des rituels idiots et des superstitions vides de sens. La dernière scène du film, splendide, - et que je ne raconterai pas - nous montre justement cela: Clara qui elle seule sait tout ce qu'il y a à savoir sans pouvoir pourtant le partager avec quiconque, enfin seule et enfin libre, réaliser ce rêve fusionnel et d'évasion.
D'où la belle surprise de cette Clara Sola qui rallume les feux d'un vrai cinéma fantastique, dans le sens littéraire du terme, un fantastique qui sème le doute, moleste le réalisme et envoie paitre les cadres édictés par l'époque. Nathalie Alvarez Mesen nous a ravivé là une superbe figure de sorcière.
Dans le rôle-titre, avec ses regards noirs de guerrière apache prête à vous bondir dessus, la comédienne Wendy Chinchilla Araya (ce nom !) est tout simplement incroyable.