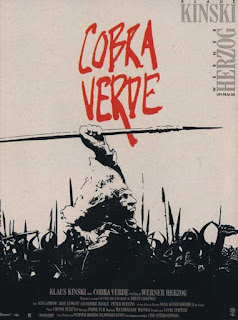Méfiance toute naturelle vis à vis de ce type de reportage, apanage des anglo-saxons qui, sous couvert d'intimité et/ou d'expertise avec le spécimen observé, tombent assez vite dans les rets de la bête hagiographie racoleuse. Ce 20000 JOURS SUR TERRE ne déroge pas vraiment à la règle, même si la bestiole auscultée ici vaut bien évidemment le détour, j'ai nommé l'impeccable Nick Cave. Jane Pollard & Iain Forsyth nous exhibent donc l'animal, bête de scène et rock-star Nick Cave, filmé alors qu'il préparait PUSH THE SKY AWAY, c'était donc en 2014, juste avant que la star australienne ne soit frappé par un deuil terrible (la mort accidentelle d'un de ses fils), et ne lui inspire deux albums d'une inspiration encore plus noire que d'habitude, si c'était Dieu possible.
Le film n'évite pas vraiment les travers de l'exercice. Cave, toujours tiré à quatre épingles, jamais pris en défaut de la plus petite faute de goût, s'y exhibe même en de courtes séquences assez éloquentes en plein auto-dépiautage chez le psy où il parle, un peu, de son enfance heureuse et de l'ombre tutélaire encombrante qu'a longtemps été son père, pasteur aux principes assez stricts. On repassera donc pour ce qui est du prétendu trauma originel, et on s'appliquera plutôt à penser que le bonhomme a su assez vite se tordre les méninges et se torturer l'esprit tout seul comme un grand.
Apanage des grands, des vrais artistes, Cave n'y dévoile pas quelque "recette": tout est inné chez lui. Ceux qui voudraient obtenir quelques détails croquants sur sa vie intime en seront pour leurs frais: tout juste assiste-t-on à un collage de photogrammes d'"idéaux" féminins en accéléré pour définir le coup de foudre qu'il a éprouvé lors de sa rencontre avec sa dernière épouse (une déclaration d'amour qu'on souhaite à toutes les femmes aimées du monde, d'ailleurs). Cave ne s'y montre pas d'une noirceur totale, comme le laisseraient penser ses chansons qui, elles, le sont. Mais c'est vrai que par ailleurs, la rock-star ne semble pas vraiment s'"ouvrir" totalement, ni à la faveur des auteurs du film, ni envers ces musiciens. Rien que de bien normal dans la vie du grand homme: un lent travail d'écriture, des répétitions où les gestes se suffisent (avec les Bad Seeds, c'est une affaire qui dure depuis tellement longtemps), tout juste s'amuse-t-il, lors de retrouvailles avec la pop-sister Kylie Minogue, amie de longue date, qu'une fois, une seule fois, les fans de la pin-up se sont cru obligé de jeter une oreille à un album entier de Nick Cave, et que ça avait du leur faire drôle.
Rien de très saisissant, finalement. Même Warren Ellis, avec sa dégaine de Charles Manson voûté, s'avère être un compagnon de jeu fort affable, discret et charmant. Tout juste sera-t-on titillé par cette fascination commune, ressentie un jour lors d'un concert de Nina Simone, vers la fin de sa vie, qui terrorisait son entourage et jouait sur scène comme habitée par le Diable. C'est ce "truc" qui a toujours fasciné Nick Cave, la part d'ombre qui a toujours fait partie de lui et qu'il a fait sortir tout au long de sa carrière.
Un grand artiste, pour un film somme toute très attendu.
Toujours en musique, même si vraiment ça n'a aucun rapport, j'ai revu UNE CHAMBRE EN VILLE de Jacques Demy, comédie musicale très noire de 1982, qui m'avait beaucoup impressionné la première fois que je l'avais vu. Incroyable de voir comment ce drame politique et social "chanté" passe la rampe de notre incrédulité au bout de dix minutes. Exit Michel Legrand et ses airs guillerets, Demy avait fait appel à Michel Colombier pour une partition où il n'est plus question de parapluies roses bonbons et de jupettes qui volettent dans le soleil de midi. Grève générale, matraques de CRS et adultères sur fond de grogne sociale et d'inégalité des classes, le soleil de Nantes s'est exilé derrière les murs gris, les bourgeoises insatisfaites se promènent nues sous leur manteau de fourrure et les prolos ont faim.
Pas étonnant que le film ait été mal accueilli à sa sortie, car ici rien n'est gai, vraiment. Il n'y a que la petite Violette, la fiancée enceinte et trompée du héros, pour revêtir quelques couleurs d'espoir (toute violette donc, évidemment), mais c'est bien la seul à sembler s'être échappée des DEMOISELLES DE ROCHEFORT. Pour le reste, même si Demy s'amuse toujours autant avec les couleurs vives, elles semblent cloisonnées dans le gris. Il faut voir Piccoli, ici teint en roux avec collier de barbe de vieux prof, et ses costumes verts par exemple: ça pourrait taper l'oeil mais sa blouse grise de petit commerçant veule a vite fait de ne laisser filtrer aucun jour.
Aujourd'hui encore, le film laisse baba: fallait-il être inconscient, et très sûr de ces capacités de cinéaste, pour parler de lutte des classes sur fond d'histoire d'amour qui finit mal ? Et en chansons !!! L'échec public du film a, parait-il, beaucoup affecté Demy et c'est d'ailleurs là son dernier grand film. Comme tout grand film qui semblait déjà daté à sa sortie, UNE CHAMBRE EN VILLE n'a pas vieilli: il n'a pas pu.
Je me disais pas plus tard qu'hier que j'allais me mettre une pleine ventrée de Werner Herzog, et puis j'avais oublié que le bonhomme était capable du meilleur comme du pire. J'ai pu vérifier ça avec LE PAYS OU REVENT LES FOURMIS VERTES (1984), réalisé deux ans après FITZCARRALDO.
On émettra cette hypothèse que le cinéaste était encore rincé par le tournage cintré de son précédent, car rien n'accroche vraiment dans ce conte naïf, un poil pontifiant et pas drôle du tout, sur la révolte tranquille d'aborigènes qui bloquent un chantier en plein désert. Fable écologiste revendiquée, le film de Herzog figure pourtant bien loin derrière deux films de son époque, LA DERNIERE VAGUE de Peter Weir (qui a vieilli mais reste un film assez sidérant sur la culture aborigène et sa cosmogonie fabuleuse), et surtout WALKABOUT de Nicholas Roeg, très grand film sur le choc des civilisations.
Pour tout dire, on a éteint avant la fin tellement Herzog ne semble pas bien savoir comment traiter, de front ou de biais, son grand sujet et ses aspirations écolo avant l'heure. La présence du comédien Bruce Spense n'arrange pas les choses (ce grand dadais incarnait ce fada à lunette dans Mad Max 2, c'est étrange comme certains rôles peuvent délimiter une carrière), et on s'attend toujours à ce que son personnage bondisse dans tous les sens en poussant des cris idiots. Mais non, même pas ça: c'est, en plus, un film de facture assez sage, pour un Herzog. Il devait vraiment être très, très fatigué.