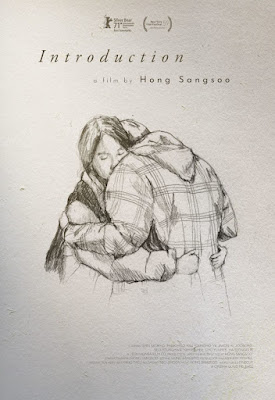A l'heure où les plateformes de streaming nous proposent à foison des mini-séries comme des séries à rallonge, il faut d'abord saluer cet effort assez kamikaze de vouloir sortir en salles un film de plus de quatre heures découpé en deux parties, programmées en même temps. Joanna Hogg n'est pas Denis Villeneuve, ceci n'est pas un blockbuster à gros budget, cela sent un peu l'accident industriel à l'arrivée. Or, par un heureux hasard du calendrier, votre serviteur a pu s'offrir ces deux tranches de cinéma en salle, avivé par des échos assez disparates il est vrai, mais plutôt laudateurs, sur ce qui semble être la grande oeuvre d'une cinéaste plutôt discrète.
De Joanna Hogg j'avais pu voir Unrelated (2007), chronique sympathique d'un été en Toscane vécu par une quadra esseulée et il n'y avait pas de quoi trop s'emballer non plus. Chaque partie de The souvenir a été tournée avec deux ans d'écart et la cinéaste a pu longuement s'exprimer là-dessus: la part autobiographique de l'histoire qui y est racontée est plus qu'apparente. C'est d'abord l'histoire d'amour entre Julie et Anthony, c'est ensuite la vie de Julie sans Anthony, et comment leur histoire va irriguer la suite de sa vie de femme, et d'artiste.
Ce qui a sans doute beaucoup plu à un pan éclairé de la critique, c'est ce fameux mécanisme qui consiste à imbriquer le tournage d'un film dans le film lui-même, un jeu assez apprêté de poupées russes qui culmine en ce plan final qui, plus que d'éclairer le film tout entier, flirte avec la coquetterie. Autant on aime ces séquences d'une équipe de cinéma au travail (Julie est étudiante dans une école de cinéma, où chaque étudiant doit produire un film de fin d'étude auquel tout le monde participe), autant on est moins convaincu par la nécessité de vouloir souligner juste sous notre nez: "voyez, ça c'est la vie, ça c'est du cinéma, voyez comment les deux peuvent se confondre". Ce sont des choses que, de Boulevard du crépuscule jusqu'à Chasseur blanc coeur noir de Eastwood en passant par La nuit américaine, nous avons déjà vu.
Pour autant, Joanna Hogg voit juste lorsqu'elle épingle cet étudiant très infatué de sa personne et qui, se prenant déjà pour un grand, pourrit son entourage parce qu'il n'arrive pas à leur soutirer une "vérité" sur son propre travail. Une attitude de merdeux que Hogg met très justement en contrepoint de celle de Julie, timide et peu sûre d'elle, toute embêtée lorsque son chef opérateur disjoncte à force de devoir composer avec son indécision.
Belle idée aussi de nous montrer un film que Julie n'a absolument pas filmé lors de la projection finale: ces images n'existent que dans sa tête, elles ne correspondent absolument pas avec celles qu'on l'a vu filmées. Et c'est tant mieux d'ailleurs, tant ce ragoût rococo méritait bien de rester uniquement dans sa tête.
The souvenir est un roman de formation, le bildungsroman d'une jeune fille à papa-maman née avec une cuillère en argent dans la bouche qui veut devenir une artiste. Sa grande histoire d'amour finira mal, comme les histoires d'amour en général, et elle ne trouvera rien de mieux à raconter dans son premier film que cette histoire, la seule qui importe.
Quand un journaliste lui demande si elle a des projets, Julie répond qu'elle devra sans doute attendre la trentaine avant de se lancer dans quelque chose de personnel. Pour l'instant, dit-elle en substance, elle se "remplit" et ne sait pas encore ce qui pourra plus tard en sortir.
Ce qui est cohérent avec la filmographie de Joanna Hogg (beaucoup de séries TV, 5 longs-métrages seulement), comme l'est d'avoir écarté le numérique au profit de la pellicule (un grain qui se voit, très belle image signée David Raedecker) ce qui colle parfaitement avec cette nostalgie affirmée des téléphones filaires, des machines à écrire, et une bande-son pop-rock délicieuse à vous faire replonger dans la nostalgie des années 80 tête la première.
La petite musique de The souvenir ne vous attrape pas grâce à ces tours de passe-passe entre fiction et réalité, mais par son attachement aux petits riens de la vie même. Porté en cela par des comédiens d'une justesse parfaite dont une Tilda Swinton "au naturel" partageant de belles scènes avec sa propre fille (Honor Swinton-Byrne, solide et fragile dans le rôle de Julie) ou encore ce "beau bizarre" de Tom Burke, présence physique à la fois douce et inquiétante qui incarnait Orson Welles dans le Mank de Fincher, ou encore le grand frère taré de Ryan Gosling dans Only god forgives.
Si on veut oublier ses accès par moment un peu chichiteux, The souvenir finit par marquer durablement. Pour le mystère de cet attachement de Julie à ce drôle de type, pour le vide jamais rempli d'une vie qu'Anthony n'a peut-être jamais vécu. Finalement, Joanna Hogg aura attendu beaucoup plus que ces 30 ans pour que tout cela sorte au grand jour.